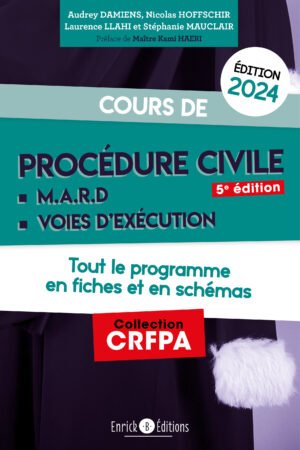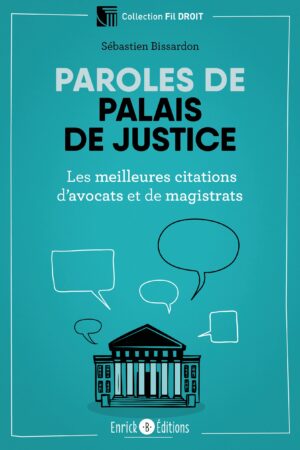Description
Depuis un siècle, le statut d’institution politique de la langue française a considérablement été renouvelé par de nombreux textes qui ont doté notre langue d’une gouvernance politique ou l’ont assorti d’une vaste bureaucratie nationale et internationale (la Francophonie). C’est dans la même période que s’est développé un imposant appareil de normes légales à travers lequel l’État oblige les personnes vivant en France, aussi bien les Français que les étrangers, ou bien à un patriotisme linguistique ou bien à un loyalisme linguistique. Enfin, nombreuses sont les immixtions du droit dans la consistance même de la langue, depuis les réformes de l’orthographe jusqu’au travail terminologique coproduit par les administrations et l’Académie française, en passant par les politiques d' »amélioration », ou de « simplification », de la qualité linguistique du droit, de la justice et de l’Administration.
Ce que montre ce livre, c’est que cette emprise du droit est le nom d’une inquiétude linguistique nourrie par plusieurs facteurs politiques, qui vont de la domination internationale de l’anglais à la réaffirmation des identités régionales, en passant par l’intégration européenne, la « question immigrée », la desquamation de « l’art » de parler ou d’écrire le français. Cette emprise est néanmoins paradoxale dans la mesure où ce droit est à la fois le symptôme et le remède d’un mal diagnostiqué par Roland Barthes comme étant d’abord et nouvellement celui d’un défaut d’amour des Français pour leur langue. Comment passer du droit à la langue française institué par la loi à l’amour de la langue française ? Telle est, au fond, la question posée par cet essai.
Auteur(s)
Pascal Mbongo
Pascal Mbongo est diplômé de l’École des hautes études en sciences sociales, professeur des facultés de droit à l’université de Poitiers, avocat au barreau de Paris, président du Cercle français de droit des médias et de la culture. Ses activités d’enseignement, de recherche et de conseil portent sur les libertés fondamentales et l’État de droit, la Constitution et les institutions politiques, les médias et la culture, en France et aux États-Unis.